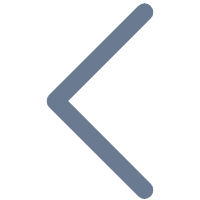Récemment, la Terre a montré un peu de caprice enfantin, souhaitant ardemment "grandir" comme nous l'avons fait dans notre enfance.
Le 29 juin, la rotation de la Terre a été plus courte de 1,59 milliseconde que les 24 heures standard, ce qui en fait la journée la plus courte enregistrée depuis que les humains ont commencé à utiliser les horloges atomiques.
Le 26 juillet a vu une journée tout aussi brève, plus rapide de 1,5 milliseconde. Cette accélération de la rotation de la Terre suggère que les jours raccourcissent.
En tant que membre du vaste cosmos, la Terre est soumise aux forces gravitationnelles exercées par les corps célestes, provoquant des ajustements constants dans sa rotation et son orbite.
Actuellement, la rotation de la Terre s'accélère, entraînant des journées plus courtes. Les scientifiques attribuent cette accélération au vacillement de Chandler, comme rapporté lors de la Réunion annuelle de la Société des géosciences Asie-Océanie.
Mais quel est le principe derrière la mesure du temps par horloge atomique ? La rotation de la Terre s'accélère-t-elle vraiment ? Il existe trois systèmes de temps standard : le Temps Universel (TU), basé sur la rotation de la Terre ; le Temps Éphéméride (TE), basé sur l'orbite de la Terre autour du Soleil ; et le Temps Atomique (TA), basé sur la fréquence des oscillations atomiques.
Le développement des systèmes de temps est passé des normes astronomiques aux normes atomiques. Le temps astronomique est dérivé des mouvements périodiques des corps célestes tels que le Soleil, la Lune et les étoiles, ce qui inclut TU et TE.
Le temps nucléaire est basé sur les ondes électromagnétiques précises émises ou absorbées lors des transitions atomiques facilitées par les horloges nucléaires.
Le temps atomique est apparu à la fin des années 1940 et au début des années 1950, avec la définition de la seconde passant des normes astronomiques aux normes atomiques en 1967.
Le Comité international des poids et mesures a défini la seconde comme la durée de 9 192 631 770 périodes de radiation correspondant à la transition entre deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium-133.
Cela a marqué l'avènement des secondes atomiques, le 1er janvier 1958 étant le point de départ du temps nucléaire.
La relation entre TU et la rotation de la Terre est intime: si la rotation de la Terre s'accélère, TU aussi, et vice versa. Par conséquent, l'écart entre le temps atomique et TU augmente avec le temps.
Actuellement, le Temps Universel Coordonné (UTC), basé sur le temps atomique, est la norme internationalement reconnue. Des secondes intercalaires sont périodiquement ajoutées ou soustraites pour maintenir UTC en synchronisation avec TU. Lorsque la différence accumulée entre le temps atomique et TU atteint 0,9 seconde, un ajustement de seconde intercalaire est effectué sur UTC.
La durée moyenne de la rotation de la Terre est de 23 heures, 56 minutes et 4 secondes. Des études suggèrent que sa rotation a progressivement ralenti depuis la formation de la Terre, avec une augmentation prévue d'une demi-heure dans la durée d'une journée au cours du prochain milliard d'années.
Cependant, sur des échelles de temps plus courtes, comme des dizaines ou des centaines de milliers d'années, des facteurs tels que l'affaiblissement des forces de marée lunaires ralentiront encore la rotation de la Terre.